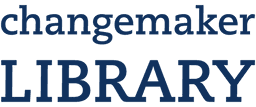Changemaker Library utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités améliorées et analyser les performances. En cliquant sur "Accepter", vous acceptez de paramétrer ces cookies comme indiqué dans le Politique de cookiesCliquer sur "Déclin" peut empêcher certaines parties de ce site de fonctionner comme prévu.
Amalia FischerBrésil • Ashoka Fellow depuis 2003
Amalia E. Fischer a fondé le premier fonds pour les femmes au Brésil pour promouvoir l'égalité des sexes. Grâce à ce fonds, Amalia sensibilise aux contributions des femmes et aux problèmes des femmes, tout en modifiant les modèles de dons philanthropiques traditionnels.
La personne
Amalia est née à Managua et a passé une grande partie de son enfance entre la ferme de sa grand-mère maternelle dans la campagne nicaraguayenne et la maison de sa grand-mère paternelle au Mexique. La mère de sa mère a été la première femme enseignante au Nicaragua et a appris à Amalia à lire et à aimer la terre. Amalia a appris à jardiner et à cueillir du coton en été. La mère de son père l'a inspirée à apprendre et a fait d'elle une amoureuse des histoires, de la culture indigène, de la poésie et de la lutte pour la justice sociale. Les parents d'Amalia ont soutenu et encouragé l'éducation de leurs enfants, aidant même le frère d'Amalia à étudier à l'étranger. Mais quand Amalia est allée voir son père pour lui proposer de faire de même, il n'en a pas vu l'importance puisque ses perspectives de carrière n'étaient pas significatives. Elle n'a pas cédé et a obtenu le soutien de sa mère et l'a finalement convaincu de l'aider à réunir les fonds nécessaires pour passer un an à étudier en Belgique. Là, elle a été exposée à un monde de culture, d'art et d'information et s'est rapidement impliquée dans des organisations de femmes composées de leaders féministes d'Amérique latine. Elle était à Paris lorsque la guerre dans son pays d'origine a éclaté. Certains de ses amis et collègues des groupes chrétiens auxquels elle avait participé ont tenté de la convaincre de revenir se battre pour le gouvernement sandaniste. Mais bien qu'elle ait sympathisé avec de nombreux idéaux du mouvement, les propres idéaux d'Amalia étaient fixés sur la non-violence. Inspirée par Martin Luther King et en tant que partisane de la démocratie, de l'égalité et de l'inclusion, elle ne participerait pas à des actions violentes pour la cause sandiniste. En quittant l'Europe, elle a décidé de ne pas vivre dans son pays déchiré par la guerre et est plutôt retournée chez sa grand-mère au Mexique. Au Mexique, Amalia a poursuivi ses études et est devenue professeur de sociologie politique à l'Université autonome du Mexique à l'âge de 21 ans. À l'université, elle s'est concentrée sur l'égalité des sexes et a cofondé le Centre d'études sur les femmes et le Centre de recherche et de Renforcement des capacités des femmes. Quand Amalia a augmenté son activité dans le mouvement féministe, elle s'est rendu compte que sans ressources, il était difficile de transformer les conditions d'inégalité que vivent les femmes. Elle s'est inspirée de deux exemples au Mexique : Semillas, un fonds de ressources pour les femmes et le Centre mexicain de philanthropie. Son autre source d'inspiration est venue de deux fonds pour les femmes du Nord : Mama Cash en Hollande, qui a financé bon nombre de ses recherches sur le féminisme en Amérique latine, et le Fonds mondial pour les femmes aux États-Unis. En 1996, Mama Cash a invité Amalia à être leur représentante au Brésil. Inquiète d'assumer ce rôle d'étrangère, elle consulte des collègues brésiliennes du mouvement féministe et leur fait part de son idée de créer un fonds pour les femmes au Brésil. La réponse enthousiaste et l'offre de soutien l'ont convaincue que le moment était venu et elle a commencé à concevoir et à négocier la création du Fonds Angela Borba, un nom choisi en l'honneur d'un leader dans la lutte pour les droits des femmes et re-démocratisation au Brésil.
La nouvelle idée
Amalia a créé un mécanisme d'investissement social axé sur la diversité au Brésil, un mécanisme qui place l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes au centre d'une nouvelle philanthropie. Elle a fondé le Fonds Angela Borba pour investir spécifiquement dans des projets indépendants par et pour les femmes. Le fonds adopte une approche pionnière de l'investissement social, étant l'une des rares organisations du pays qui, contrairement aux fondations d'entreprises et aux institutions de financement qui créent et administrent leurs propres programmes sociaux, collectent des fonds afin de les rediriger vers des programmes existants et indépendants. Amalia travaille à moderniser la culture de la philanthropie et les pratiques d'investissement social au Brésil en lançant une campagne impliquant des entreprises, des instituts et des donateurs individuels. Son objectif est de transformer la mentalité de « don » des gens en une compréhension plus profonde de l'importance d'investir socialement dans la diversité et de transformer les relations entre les sexes. Son message affirme qu'un investissement bien placé dans l'autonomisation socio-économique, culturelle et technologique des femmes génère des rendements élevés en termes d'investissement de ces femmes dans les enfants, les adolescents et la société dans son ensemble.
Le problème
Malgré de nombreuses avancées dans la reconnaissance des droits des femmes au Brésil, les femmes continuent d'être confrontées à la discrimination, à l'inégalité, à la violence et au manque d'opportunités en raison de leur sexe. Cette réalité a un effet direct sur le développement économique et social du pays si l'on considère le rôle important que les femmes ont et continuent de jouer tant au foyer qu'au travail. Près de 25 % des femmes économiquement actives sont chefs de famille, ce qui équivaut à 11,2 millions de femmes qui sont les seules à subvenir aux besoins de leur famille. Bien que l'écart entre les salaires des hommes et des femmes ait quelque peu diminué, les femmes continuent de gagner 30 % de moins que leurs homologues masculins dans la même profession. La violence à l'égard des femmes est une pratique cachée et normalisée ; les projections de la Fondation Abramo citent 6,8 millions de femmes brésiliennes régulièrement battues. La situation des femmes de couleur est plus grave ; le manque d'accès aux opportunités éducatives et professionnelles représente des conditions de vie précaires pour ces femmes et leurs familles. Parmi les femmes noires économiquement actives, la grande majorité se livrent à un travail manuel, 51 % travaillant comme domestiques. Le salaire moyen des femmes blanches est près de trois fois supérieur à celui des femmes noires, qui gagnent moins de 80 dollars américains par mois. Au cours des 15 dernières années, les femmes au Brésil ont formé des organisations pour aborder des questions telles que l'emploi, la violence, la formation professionnelle et la santé en plus de l'égalité des sexes et des droits humains des femmes. Ces organisations ont mené leur travail en grande partie grâce au soutien d'organismes et d'organismes de financement internationaux. Cependant, de nombreuses organisations de femmes traversent une crise économique étant donné la réduction de l'aide internationale au Brésil, le manque de savoir-faire en matière de collecte de fonds et de mobilisation de ressources, et le manque d'intérêt des entreprises et fondations nationales à investir dans les questions liées au genre et les droits des femmes. Actuellement, les organisations de femmes signalent que seulement 10 % du financement du programme provient d'entreprises brésiliennes. Dans une étude de 2000 sur "l'action sociale des entreprises" menée par l'IPEA dans la région du sud-est du Brésil, concentrée en affaires, les relations entre les sexes n'étaient pas incluses dans l'agenda des priorités du secteur privé. Seulement 7 % des entreprises soutiennent l'action sociale promue par les femmes. Plusieurs facteurs contribuent au manque d'investissement dans les organisations et les programmes de femmes qui traitent de l'égalité des sexes. La société brésilienne n'a pas encore reconnu l'importance d'investir dans les femmes à la fois comme une forme de promotion de l'égalité et comme une stratégie de transformation sociale et de développement socio-économique. En tant que consommatrices, les femmes influencent à près de 100 % l'achat de produits alimentaires et de produits d'entretien ménager et d'hygiène. Ils détiennent plus de 40% des titres des comptes chèques et d'épargne des deux banques fédérales brésiliennes, Banco do Brasil et Caixa Economico. Malgré ce rôle de consommatrice active, les pratiques de philanthropie d'entreprise ne tiennent pas compte de l'importance des femmes dans l'économie. En plus d'un manque de compréhension du rôle des femmes dans l'économie, il y a aussi un manque de visibilité et de diffusion des programmes réussis et des projets de changement social qui sont conçus et exécutés pour et par les femmes. En outre, de nombreuses idées fausses persistent sur les groupes de femmes. Les entreprises et les institutions de financement ont tendance à percevoir les organisations de femmes comme exclusives, anti-masculines et radicales, inhibant leur désir d'investir. Ironiquement, dans ce tableau national, une étude de 2000 « Dons et travail bénévole » (Landim et Scalon) montre que 60,1 % de tous les types de dons par les institutions au Brésil sont effectués par des femmes.
La stratégie
Lorsqu'Amalia a déménagé au Brésil en 1997, elle a entrepris de changer les modèles d'investissement social dans le pays afin de donner la priorité aux relations entre les sexes et à la diversité. La première étape d'Amalia a été de créer un fonds qui orienterait les ressources vers les organisations et initiatives de femmes. Dans le même temps, le fonds et sa campagne d'éducation correspondante augmenteraient la compréhension et la visibilité du rôle important des femmes dans le développement socio-économique du pays. Amalia a commencé par exprimer son idée de créer un tel fonds et a obtenu le soutien et la contribution de collègues et de leaders des droits des femmes. Initialement lancé comme un programme au sein de l'organisation de défense des droits des femmes CEMINA à Rio, Amalia a fondé le Fonds Angela Borba en 2001 avec le soutien financier initial de la Fondation Ford et du Fonds mondial pour les femmes. Après avoir obtenu ce soutien et cette crédibilité, Amalia a enregistré le fonds de manière indépendante et a structuré l'institution sur la base des mêmes valeurs de diversité et de promotion des initiatives féminines. Elle a créé un conseil d'administration pour examiner les propositions, composé de neuf conseillers de diverses origines ethniques, races, orientations sexuelles et âges. Elle a établi les paramètres du fonds pour soutenir des projets qui favorisent l'emploi et l'indépendance économique des femmes, améliorent l'accès à l'éducation formelle et non formelle, combattent la violence à l'égard des femmes, améliorent la santé des femmes, abordent l'accès à la technologie et à la communication, soutiennent l'art et la culture des femmes et défendent la diversité et la différence aux niveaux ethnique, racial, sexuel et générationnel. Les priorités de financement comprennent une approche à trois volets pour soutenir les groupes qui n'ont pas la possibilité de mobiliser des ressources par d'autres moyens, dont les programmes et les projets promeuvent les droits humains des femmes, et les organisations spécifiquement dédiées aux femmes lesbiennes, noires ou autochtones. groupes. Amalia a développé un processus de sélection astucieux qui reflète les valeurs du fonds : éthique, diversité et égalité. Les candidats doivent soumettre leurs projets sous un pseudonyme avec toutes les informations sur l'organisation et les références contenues dans une enveloppe scellée. Amalia a créé cette méthode à la fois pour éviter le favoritisme basé sur des relations personnelles et pour s'assurer que le financement est effectué au mérite selon des critères explicites. Cela permet un meilleur accès pour les organisations qui ne sont pas « connectées » dans une culture consistant à obtenir ce que l'on veut par qui l'on sait. Les mesures prudentes d'Amalia ont rendu le processus de sélection aussi objectif que possible. En novembre 2001, Amalia et son équipe ont ouvert le premier appel à propositions. En un mois, le fonds a reçu 110 projets de quatre des cinq régions du Brésil. En février 2002, le conseil s'est réuni pour sélectionner 14 projets devant bénéficier du soutien du Fonds Angela Borba. Chacune des organisations bénéficie (en moyenne) à 800 femmes sur un total de 11 200 femmes directement concernées. En plus de stimuler un changement dans la façon dont les entreprises et les individus mènent leurs pratiques philanthropiques, la stratégie d'Amalia pour créer une source de financement durable pour le Fonds Angela Borba implique la mobilisation de divers secteurs de la société. Premièrement, elle aborde la nécessité de documenter les résultats et de cartographier les organisations de femmes au Brésil afin de prouver leur importance dans la transformation sociale. Pour ce faire, elle a engagé trois volontaires universitaires (avec un coordinateur du personnel) qui sont actuellement engagés dans une vaste étude sur le genre et le développement social au Brésil. Elle utilise les résultats de cette étude pour organiser des ateliers et des petits-déjeuners avec des entreprises pour discuter de l'importance des relations entre les sexes et de l'égalité. Elle crée également à la fois le "Fonds des amis d'Angela Borba" - une association servant de banque de donateurs et de sympathisants - et un conseil d'administration honoraire composé de femmes leaders célèbres et très respectées du monde des affaires, du gouvernement et secteurs sociaux à prêter leur nom pour soutenir l'initiative. Amalia pense que grâce à cette campagne d'éducation agressive, elle peut changer la culture de l'investissement au Brésil et créer une source de financement nationale. Dans cinq ans, elle envisage de soutenir le fonds presque exclusivement sur des mesures "financées localement". Amalia reconnaît également la nécessité d'un changement législatif au Brésil afin de créer des incitations à l'investissement social. Elle milite pour la réforme des lois fiscales qui créeraient des déductions fiscales pour les donateurs et pour la capacité du fonds à maintenir une dotation. Dans 10 ans, Amalia envisage de créer une dotation pour le fonds afin d'assurer sa pérennité à long terme.