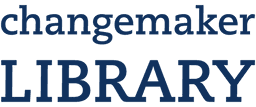Changemaker Library utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités améliorées et analyser les performances. En cliquant sur "Accepter", vous acceptez de paramétrer ces cookies comme indiqué dans le Politique de cookiesCliquer sur "Déclin" peut empêcher certaines parties de ce site de fonctionner comme prévu.
Annette Mbaye D'ErnevilleSénégal • Le Musée de la Femme Henriette Bathily
Ashoka Fellow depuis 2009
Ashoka Fellow depuis 2009
Le Musée de la Femme Henriette Bathily d'Annette Mbaye D'Erneville sur l'île de Gorée dans le port de Dakar a été le premier musée de la femme en Afrique. L'idée d'un musée des femmes axé sur les questions relatives aux femmes de cette région particulière de l'Afrique où se trouve le musée (vs. "Femmes africaines") a été copiée dans un musée permanent au Mali et le thème a été repris dans des expositions itinérantes autour le monde.
La personne
Annette travaille à la promotion des droits et du statut social des femmes au Sénégal depuis de nombreuses décennies. Née en 1926, Annette fait ses études au Sénégal et obtient son diplôme de professeur à l'École Normale de Rufisque au Sénégal en 1945. Deux ans plus tard, elle part pour Paris étudier le journalisme. Annette a été la première femme journaliste professionnelle au Sénégal et a été une pionnière dans la lutte contre la décolonisation et une ardente défenseure de la négritude et du panafricanisme. Ses émissions de radio de Paris à la fin des années 1940 ont été reprises et portées par des émissions de radio africaines. Annette est revenue au Sénégal à la veille de l'indépendance en 1957. Après avoir obtenu son diplôme en journalisme, elle a commencé à écrire des articles sur les problèmes sociaux et les obstacles rencontrés par les femmes. Pourtant, Annette voulait « faire quelque chose [de plus], pour nous, les femmes d'Afrique, à l'arrivée des indépendances ». Ainsi, avec le soutien d'autres leaders du mouvement féministe au Sénégal, elle fonde en 1959 le magazine féminin sénégalais Femmes de Soleil, qui sera plus tard rebaptisé Awa (1963). Annette stimule la discussion à la fois professionnellement au musée et dans sa vie sociale : elle dirige une journée portes ouvertes informelle à Dakar et organise des déjeuners le dimanche où des femmes artistes, journalistes, politiciennes, amies et famille se joignent à un dialogue informel et intergénérationnel sur la culture sénégalaise. . En 2008, son fils réalise et sort un film, Merbi, qui est un portrait de sa mère en tant que première femme journaliste du Sénégal.
La nouvelle idée
En 1977, Annette a joué un rôle clé dans la création de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS), une fédération de centaines de groupes de femmes sénégalaises, et est aujourd'hui présidente d'honneur de l'organisation. C'est à travers son travail avec FAFS qu'Annette, inspirée par la série de profils sur les femmes de l'organisation, a commencé à développer l'idée de créer une exposition permanente sur les femmes; présentant des produits fabriqués par des femmes, explorant l'histoire des femmes et présentant le travail d'organisations de femmes. Annette est la fondatrice et directrice du Musée de Bathily au Sénégal, qui vise à "apporter sa contribution à l'éducation et à la valorisation du patrimoine culturel sénégalais en promouvant le rôle et la place de la femme dans la société". Le musée a été créé en 1994, sur la base des idées d'Ousmane William Mbaye (fils d'Annette) en collaboration avec le Consortium de la Communication Audiovisuelle Africaine, l'aval de la première femme Premier Ministre du Sénégal, de plusieurs directeurs de musées à Dakar, et avec le soutien de le gouvernement canadien. Au moment de sa création, c'était le premier musée de la femme en Afrique. Annette utilise les médias comme outil instrumental pour sensibiliser aux problèmes des femmes. En 1996, les Rencontres Cinématographiques de Dakar, un festival annuel du film à Dakar qu'elle a fondé au début de la décennie, ont axé leur thème sur "Les femmes et le cinéma", proclamant comme devise "Quand les femmes de cinéma agissent, le cinéma africain va de l'avant." Au cours de ces années, Annette a également occupé plusieurs postes gouvernementaux, dont celui de commissaire à l'information régionale à Diourbel et de directrice des programmes de Radio Sénégal.
Le problème
La promotion d'un statut positif pour les femmes et la remise en question des perceptions et des représentations négatives des femmes africaines à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique ont été la pierre angulaire du mouvement des femmes au Sénégal pendant des décennies. Alors que de brusques changements économiques et politiques se sont produits depuis l'indépendance dans les années 1960 et que les sociétés traditionnelles intègrent de plus en plus d'éléments du modernisme et du post-modernisme ; les femmes dans les systèmes fortement patriarcaux en Afrique de l'Ouest ont perdu bon nombre des rôles positifs qu'elles détenaient traditionnellement. Les nouvelles cultures apportent aussi de nouveaux défis que les femmes ne sont pas toujours équipées pour affronter. Il existe des traditions séculaires d'organisation parmi les femmes à travers leurs groupes d'âge, leurs affinités professionnelles et leurs liens familiaux. Quand Annette a fondé FAFS, la plupart des groupes travaillaient pour l'autonomisation économique, par le biais de coopératives ; certaines portaient sur les droits des femmes et d'autres sur le statut politique des femmes. Il y a eu des milliers d'organisations de femmes qui se sont levées pour répondre aux besoins multiples de groupes particuliers, mais elles étaient dispersées géographiquement et ne constituaient pas une force politique forte. Même si de nombreuses activités étaient engagées, il y avait aussi très peu de capacité à saisir les contributions des femmes à l'avancement des sociétés, avec très peu de visibilité sur leurs besoins et leurs résultats. Annette a réfléchi et a été au centre de la formation d'un corps plus large et d'un mouvement pour l'avancement des femmes. La remise en question de l'influence des religions révélées telles que le christianisme et l'islam, et l'analyse critique des systèmes traditionnels et modernes, exposent les injustices contre les femmes et découvrent des opportunités d'apporter des changements positifs. Annette a fait ce travail à travers FAFS et plus tard à travers d'autres organisations en utilisant des opportunités artistiques, politiques et économiques qu'elle combine avec le musée des femmes aujourd'hui. Le défi est toujours de changer radicalement la perception des femmes à l'intérieur et à l'extérieur du pays par la politique, les forces économiques et par les femmes elles-mêmes, pour correspondre à la vitalité, au dynamisme et à la créativité de leur participation à la société.
La stratégie
Le Musée de Bathily vise à exposer la complexité, la richesse et la diversité de la vie des femmes dans la société sénégalaise contemporaine et traditionnelle. La voix des femmes dans la société sénégalaise a souvent été confinée à la vie privée et, par conséquent, il n'y a pas beaucoup d'occasions de célébrer le travail des femmes dans la sphère publique. Les femmes sont souvent simplifiées en tant que symboles de l'élégance féminine, ce qui n'englobe pas l'étendue et la complexité de leurs contributions à la culture et à la société sénégalaises. De même, les questions qui concernent les femmes sont également simplifiées ou négligées, car il n'y a pas beaucoup d'espaces ou d'opportunités pour que des discussions publiques aient lieu. Le manque de dialogue sur les questions féminines, de la santé reproductive au divorce, a de graves implications pour le développement national ainsi que pour le bien-être individuel. Les expositions du musée encouragent la réflexion sur les réalisations des femmes et suscitent des discussions sur des questions en présentant les multiples facettes des rôles économiques, politiques, historiques et culturels des femmes sénégalaises. Les expositions permanentes comprennent des expositions de différentes robes ethniques, des productions artistiques, des outils de la vie traditionnelle quotidienne, des biographies de célèbres femmes leaders sénégalaises et des travaux intellectuels. Le musée abrite également des interviews, des films et des photographies créés par des femmes et sur les femmes pour articuler les divers rôles que jouent les femmes au Sénégal. Contrairement à de nombreux autres musées africains, qui ont tendance à qualifier les artefacts traditionnels de « tribaux » ou de « primitifs », le Musée des femmes présente les aspects fonctionnels des outils et des pratiques des femmes, montrant comment les femmes ont contribué à la croissance et au développement social et économique, malgré souvent passé inaperçu dans l'histoire du Sénégal. Les expositions du musée sont complétées par des ateliers et des cours de formation professionnelle ouverts au public et axés sur la génération de revenus. Le musée est un établissement d'enseignement qui promeut les réalisations des femmes en mettant en valeur leur développement socio-économique culturel tout en enseignant les droits de l'homme. L'objectif est de modifier la perception inexacte et dégradante du rôle des femmes sénégalaises dans la communauté, tant pour les habitants que pour les touristes, en promouvant la position sociale positive, l'égalité et la liberté des femmes. Le musée produit également ses propres recherches sur l'évolution des rôles des femmes dans la société et sur les défis auxquels elles sont confrontées, et organise des événements dans le but de mieux articuler la position des femmes sénégalaises de toutes les ethnies. Par exemple, le musée a accueilli une performance culturelle de « Melfeu et Gemb » pour 127 invités, une conférence sur la résistance des femmes (complétée par une exposition de photographies, « Women in Movement »), et un événement intitulé « Women's Pens » pour célébrer les femmes écrivains. . En 2005, alors que les négociations pour un traité de paix concernant le conflit séparatiste casamançais étaient en cours, le musée a organisé un colloque avec un groupe de femmes casamançaises pour discuter de la contribution des femmes au maintien de la paix au Sénégal. Tous les trois mois, le musée accueille également une conférence, qui comprend des débats, des conférences et des discussions sur des sujets controversés concernant l'excision, le mariage, la sexualité et d'autres questions qui affectent profondément la vie des femmes mais dont il est souvent tabou d'en parler ouvertement. Le musée propose au public des cours de formation d'introduction à la teinture, à la production de batik, à la broderie et au tissage de tissus (c'est-à-dire traditionnellement considérés comme un travail d'homme) afin de promouvoir la génération de revenus chez les femmes. La majorité des participantes sont des femmes de l'île, habitant Ouakam et Mbao (banlieue de Dakar), et des élèves de l'internat féminin de Gorée. Récemment, le musée a organisé des micro-jardins pour les femmes de l'île de Gorée. Le musée collabore également avec des femmes individuelles et des groupes de femmes, telles que les tisserandes Diola et les potières d'Edioungou, en commercialisant leurs marchandises dans la boutique du musée. Le musée a lancé un programme spécial pour les femmes handicapées et emploie actuellement deux femmes handicapées. Le programme leur offre des opportunités de génération de revenus qu'ils ne pourraient pas poursuivre autrement dans la société sénégalaise. En 2000, le musée a noué un partenariat avec le musée de la femme Evelyn Ortner de Merano en Italie et a organisé conjointement une exposition internationale avec le soutien d'organisations de femmes italiennes et autrichiennes, intitulée "Le travail des femmes au Sénégal, en Italie et en Autriche". En partenariat, le musée italien a également soutenu financièrement 25 jeunes sénégalaises handicapées. De 2001 à 2003, le musée a collaboré avec le gouvernement béninois et le ministère québécois de la Culture et des Communications pour organiser une exposition internationale « Femmes bâtisseuses d'Afrique », qui a fait le tour de cinq pays. Le Musée de la Femme est également membre du West African Museum Program, qui promeut la collaboration entre les musées ouest-africains en transcendant les barrières linguistiques et géographiques. Le Musée de la femme est actuellement sous la direction d'une équipe de femmes, qui s'efforcent de développer le musée en construisant des installations plus vastes sur un terrain acquis à Dakar, en ouvrant un plus large éventail d'expositions et en devenant durable. Le musée de Gorée sert de lieu de rassemblement fréquent pour les discussions locales et plus larges sur les problèmes des femmes. Le musée est également considéré par beaucoup comme un trésor national et est situé dans le bâtiment historique Victoria Albis, en face du musée de l'esclavage sur l'île de Gorée.