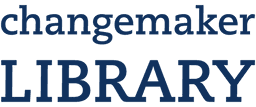Changemaker Library utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités améliorées et analyser les performances. En cliquant sur "Accepter", vous acceptez de paramétrer ces cookies comme indiqué dans le Politique de cookiesCliquer sur "Déclin" peut empêcher certaines parties de ce site de fonctionner comme prévu.
Jeronimo Villas BoasBrésil • Ashoka Fellow depuis 2015
Jeronimo travaille avec différents secteurs pour reconnaître et renforcer l'apiculture indigène, en valorisant la diversité de son produit, en générant des revenus pour ses gardiens traditionnels et en fin de compte en conservant les 250 espèces d'abeilles indigènes.
La personne
Jerônimo a passé son enfance en Amazonie et a grandi en jouant avec ses amis indigènes, car ses parents sont des anthropologues travaillant avec les peuples indigènes. Quand il avait 6 ans, sa famille a déménagé à Brasilia, mais leur maison était toujours pleine de gens de tout le Brésil et ils voyageaient encore beaucoup. Son enfance a fait que Jerônimo est tombé amoureux de la diversité - des gens et de la nature. Tout au long de sa vie, Jerônimo a vu la différence entre les informations que ses parents rapportaient de leur travail avec les tribus indigènes - comme l'avancée des plantations de soja vers les territoires indigènes - et les informations diffusées par les médias, et il a commencé à remettre en question la situation économique brésilienne. modèle de développement, qui exclut les petits groupes. Jerônimo a étudié l'écologie, lorsqu'il a effectué un stage à Imaflora (Institut de gestion et de certification agricole et forestière) sur un projet d'apiculture en Amazonie. Cette expérience l'a fait tomber amoureux des abeilles indigènes et, par la suite, toutes ses études universitaires ont été liées à l'apiculture et au miel, même s'il n'y avait pas beaucoup d'informations disponibles à ce sujet concernant les abeilles indigènes ou leur miel. Après avoir obtenu son diplôme, Jerônimo a décidé de faire une maîtrise à Paraíba, État en dehors du circuit académique respecté, mais qui avait l'utilisation traditionnelle du miel. Il y constate la présence de ruches dans les arrière-cours des habitations pauvres, ce qui devient l'objet de ses recherches. En faisant le master, Jerônimo s'est rendu compte que les communautés avaient beaucoup à apprendre à l'université à ce sujet. À l'université, il a identifié les différents acteurs mondiaux impliqués dans la gestion et la conservation des abeilles et s'est rendu compte qu'ils travaillent tous de manière isolée. Il a alors commencé son travail, pour régler les derniers détails : la nécessité de la conservation des abeilles indigènes et son impact sur l'environnement ; l'affaiblissement de la tradition de l'apiculture indigène dans les communautés ; la possibilité de générer des revenus grâce à la production de miel, des contextes nationaux et mondiaux qui valorisent les produits locaux ; l'existence de mouvements sociaux tels que Slow Food, défendant l'importance d'une alimentation durable et valorisant le rôle de ses producteurs ; l'existence d'OSC capables d'œuvrer au renforcement des filières productives du miel ; l'absence de réglementation spécifique pour les produits des abeilles indigènes et l'incapacité du gouvernement à comprendre les caractéristiques de l'agriculture familiale brésilienne au lieu de chercher des raccourcis vers la standardisation des systèmes de production. Jerônimo a également publié le Manuel de technologie : Honey Bees in a Sting, un livre qui montre la diversité des connaissances et des pratiques associées à l'élevage des abeilles indigènes au Brésil et a servi de base à ces organisations dans la lutte pour la réglementation de l'abeille indigène. chaîne de production des abeilles mellifères et la valorisation des abeilles dans les politiques publiques nationales.
La nouvelle idée
Au Brésil, il existe environ 250 espèces d'abeilles indigènes, mais la majorité des apiculteurs utilisent des pratiques conçues pour les abeilles africaines. En conséquence, les abeilles indigènes sont au bord de l'extinction et de nombreuses plantes ne sont pas pollinisées car les abeilles africaines ne sont pas attirées par elles. Face à cet enjeu environnemental grandissant, Jeronimo Villas Boas s'emploie à promouvoir la diversité des pratiques apicoles, des espèces élevées, de leurs gardiens et des produits, qui n'existent pas formellement au Brésil. Convaincu que la meilleure façon de préserver la biodiversité est de l'utiliser durablement, Jerônimo travaille à renforcer l'activité de la méliponiculture (la culture des abeilles indigènes), techniquement et conceptuellement. Jeronimo travaille avec des communautés qui pratiquent traditionnellement la méliponiculture et sont les gardiens du pays de ces insectes indigènes. En veillant à ce que les techniques soient adaptées aux communautés grâce à la participation communautaire, Jeronimo vise à renforcer la chaîne de valeur de l'industrie. Son travail génère des revenus grâce à la vente de miel, apporte la sécurité alimentaire et améliore la santé locale, car le miel peut être utilisé à des fins médicales et est un substitut sain au sucre. Il sauve également une partie de l'identité de la communauté, dans laquelle la méliponiculture joue un rôle central, et transmet les connaissances des anciennes aux jeunes générations. Sur le plan environnemental, l'apiculture indigène évite la déforestation, car la préservation de la forêt est essentielle à l'activité. De ce travail technique, Jeronimo est en mesure de rassembler des connaissances qui ne sont pas encore formalisées dans les universités, et s'associe avec elles pour les systématiser afin de créer des réglementations pour la production de miel d'abeille indigène. Jeronimo est devenu un défenseur prééminent des abeilles au Brésil et construit les bases techniques d'une réglementation qui favorise les petits producteurs. Jeronimo fait également partie du mouvement Slow Food, où il promeut les discussions entre producteurs et consommateurs de miel en Amérique latine, et il a des partenariats avec d'importants chefs du pays, pour stimuler la demande et ajouter de la valeur aux variétés de miel d'abeille indigène. Pour l'avenir, Jerônimo pense que la réglementation stimulera à la fois la consommation et la production de miel d'abeille indigène, ce qui lui permettra de reproduire ses techniques de culture des abeilles dans de nombreuses communautés à travers le Brésil. En plus de cela, la stratégie de Jeronimo pour standardiser la diversité peut être appliquée à d'autres produits naturels autres que le miel.
Le problème
L'importance des abeilles et les enjeux liés à la conservation de leur biodiversité sont désormais des enjeux mondiaux. Les abeilles sont des acteurs importants dans le maintien des écosystèmes naturels et agricoles. Selon l'ONU, 73% des espèces de plantes cultivées dans le monde sont pollinisées par une sorte d'espèce d'abeille, ainsi qu'un tiers de la nourriture consommée par l'homme. Les services de pollinisation rendus par ces insectes dans le monde sont évalués à 54 milliards de dollars par an. La contribution des abeilles à la vie végétale et au maintien de la variabilité génétique est immense. Le déclin accéléré des populations d'abeilles, principalement sauvages, est un problème qui attire l'attention des gouvernements du monde entier en raison de son énorme impact sur l'environnement, l'agriculture et le bien-être des communautés. Malgré leur importance, les gens connaissent très peu les abeilles. Il existe plus de 500 espèces d'abeilles productrices de miel sans dard en Amérique latine - 250 au Brésil seulement. La grande diversité des espèces, associée à la diversité des plantes du Brésil, permet la production de miel avec une myriade de goûts, d'arômes et de densités. L'activité d'apiculture indigène existe depuis des années, gérée par les peuples autochtones, qui sont les gardiens historiques de ces espèces d'abeilles, responsables de leur conservation. Les abeilles indigènes sont élevées de différentes manières et leur miel est utilisé à des fins différentes, telles que l'alimentation et la médecine, selon la région et la culture des éleveurs. Cependant, ces abeilles indigènes, leur miel et leurs producteurs ne sont pas formellement organisés au Brésil, car ils sont inconnus du gouvernement, du milieu universitaire et de la société en général. Quand on pense aux abeilles, on pense immédiatement à Apis mellifera, l'abeille noire et jaune qui pique, aussi appelée « abeille à miel ». Cette espèce n'est pas originaire du Brésil ou d'Amérique latine ; elle a été apportée d'Afrique par les Portugais au XIXe siècle et, en raison de sa capacité à s'adapter à différents climats et à trouver de la nourriture - nectar et pollen - dans diverses espèces végétales, l'abeille africaine a quitté São Paulo pour se répandre rapidement dans toute l'Amérique. Comme il s'agit d'une abeille très productive, la production de miel a été normalisée en tant qu'apiculture - culture d'Apis mellifera - cette activité s'est développée avec l'abeille, et aujourd'hui le miel consommé par les ménages brésiliens est le produit de ces insectes étrangers. Malgré sa productivité, l'abeille africaine ne peut pas polliniser toutes les plantes. Pourtant, le gouvernement brésilien ne reconnaît pas formellement la méliponiculture (apiculture indigène) et la législation qui réglemente le commerce des produits d'origine animale n'autorise que le commerce des produits d'Apis mellifera. Le gouvernement brésilien réglemente les produits selon la logique de l'agro-industrie - les produits qui peuvent être produits massivement sont valorisés, et les produits qui sont produits à l'échelle artisanale en utilisant les connaissances et les technologies locales sont marginalisés, parfois accusés de "menacer la sécurité alimentaire". Le miel d'abeille indigène et sa chaîne économique sont ainsi marginalisés et limités à l'échelle artisanale, malgré les variétés du produit, n'a pas beaucoup de valeur marchande. Cela empêche les communautés traditionnelles de gardiens de ces espèces, fondamentales pour la conservation de l'environnement, de générer des revenus, ou les encourage à élever des abeilles africaines. Dans les zones rurales, la plupart des habitations ont une ruche dans l'arrière-cour, qui est souvent emportée par les familles lorsqu'elles se déplacent vers les villes à la recherche de meilleures conditions de vie - la ruche représente un lien avec la terre. De plus, la transmission des savoirs culturels à la génération suivante est actuellement un défi majeur pour la vie traditionnelle et rurale. Les jeunes sont de plus en plus réticents à travailler dans les champs, en particulier dans une activité aussi sous-évaluée que la méliponiculture. De plus, peu de technologie est disponible pour accompagner les familles dans cette activité. Il existe quelques institutions rurales qui promeuvent l'apiculture indigène au Brésil pour le développement économique, comme Emater, Senar et Sebrae. Or, ces organisations « vendent » un bouquet technologique standardisé, déconnecté des savoirs locaux et peu adaptable, donc peu pérenne à moyen et long terme. Valoriser et permettre l'activité traditionnelle de « l'apiculture » est un moyen de renforcer les liens avec la terre et l'identité. Pour aider à préserver les abeilles indigènes, il est crucial de permettre leur chaîne de production et de respecter l'identité culturelle de la pratique. Le miel d'abeille a le potentiel d'attirer un marché de consommateurs qui valorise les produits traditionnels et distinctifs et pourrait offrir des opportunités génératrices de revenus aux communautés qui élèvent des abeilles indigènes.
La stratégie
Pour Jerônimo, l'appréciation des produits et des producteurs d'abeilles indigènes est essentielle pour leur conservation. Les apiculteurs sont les gardiens de l'espèce dans leurs régions d'origine, mais ils ont besoin de soutien, ou du moins d'une réduction des obstacles. Pour ce faire, il a créé Kamboas Socioambiental pour opérer à la fois dans les domaines techniques et conceptuels. Le domaine pratique assure le renforcement des chaînes de production de la méliponiculture (apiculture indigène) avec les communautés traditionnelles et les exploitations agricoles familiales dans plusieurs régions du Brésil, tandis que le côté conceptuel de son travail vise à sensibiliser à la valeur des abeilles et de leurs gardiens dans la société en général et travaille à la mise en place de politiques publiques qui reconnaissent et autorisent cette activité. Le travail technique de Jerônimo se concentre sur les communautés qui ont une relation traditionnelle et historique avec les abeilles indigènes. Son objectif est de générer des revenus et la sécurité alimentaire des familles, ainsi que la conservation des abeilles indigènes. Pour cela, il réveille les riches savoirs traditionnels de la communauté, y ajoute des savoirs extérieurs et développe des technologies sociales, toujours adaptées aux réalités locales. Son travail commence toujours par un diagnostic de la réalité locale, et cela peut aller de la mise en place de nouvelles ruches dans les communautés, à l'accompagnement du flux de production et de vente du miel. La méthodologie n'est pas basée sur une solution standardisée, mais varie selon les différentes réalités. Jerônimo rassemble les connaissances et les pratiques des communautés et d'autres formes de connaissances de tout le pays, en fonction de la situation locale, pour améliorer la production. Son approche implique les peuples autochtones et les communautés traditionnelles et respecte les modèles traditionnels d'organisation, avec un système d'adhésion volontaire aux arrangements productifs. Les communautés, parfois organisées en associations, participent à la planification générale et les orientations des projets sont élaborées en collaboration. Ce travail technique a été réalisé dans trois régions et est adapté en fonction des différences locales : dans l'État d'Espírito Santo, sur le territoire indigène des groupes Guarani et Tupiniquim ; dans l'État du Mato Grosso, avec trois groupes ethniques dans le parc indigène du Xingu ; et dans l'état de Rio Grande do Norte, avec une association de jeunes agro-écologistes de la ville de Jandaíra. À Espírito Santo, par exemple, les abeilles indigènes se sont éteintes en raison de la déforestation locale, mais les autochtones ont signalé l'habitude de manger du miel d'abeille indigène dans le passé. Ainsi, après planification et rencontres avec les communautés, un plan de sauvetage de la méliponiculture a été élaboré. 24 colonies d'une espèce que les Tupiniquins rapportaient être la plus pertinente à leurs traditions ont été acquises, et les personnes qui avaient manifesté leur intérêt à contribuer à ce projet ont participé à des cours de méliponiculture de base et sur la multiplication des colonies. Chaque famille travaille pendant un an à la multiplication des colonies, avant de démarrer des activités productives ; de nouvelles ruches sont ensuite données à d'autres familles, qui font de même. Aujourd'hui, ce territoire compte 40 centres apicoles et gère plus de 450 colonies. À Xingu, cependant, il y avait l'apiculture indigène, mais elle n'était pas utilisée comme moyen de génération de revenus. Ainsi, le défi de Jerônimo est de développer des technologies pour soutenir la génération de revenus. Parmi les technologies créées, il y a une pompe d'aspiration du miel qui fonctionne sans électricité, et un processus de maturation différent. L'un des plus grands défis du miel d'abeille indigène est de savoir comment garantir la durée de conservation, car il s'agit d'un produit plus liquide, très sensible à la fermentation. Constatant que les communautés traditionnelles ont l'habitude de consommer du miel fermenté, Jeronimo a décidé de ne pas lutter contre la fermentation, comme le font les organisations rurales, et a expérimenté la vente de miel fermenté comme produit final. Ce produit distinct, avec des nuances plus acides et légèrement alcoolisées, a été bien accueilli par le marché. Il était alors possible de mettre en vente un produit stable, un produit qui ne se détériorerait pas rapidement, avec des coûts inférieurs et des avantages grâce à ses caractéristiques particulières. Cela a également influencé le développement d'un système technologique pour répondre aux exigences de base en matière de surveillance sanitaire, en adaptant les techniques de production de bière artisanale, déjà disponibles sur le marché, pour la fermentation du miel. À Rio Grande do Norte, un groupe de jeunes travaille pour empêcher le déclin de la méliponiculture. Dans ce cas, le travail de Jerônimo soutient le renforcement du groupe, l'organisation de la production pour augmenter la productivité, la valeur ajoutée du produit et la recherche de marchés alternatifs. Le Brésil possède une grande diversité d'espèces d'abeilles, de contextes environnementaux et culturels où la culture apicole existe, de sorte que ce travail peut être reproduit dans tout arrangement productif avec mobilisation sociale. La stratégie de Jeronimo pour entrer dans ces communautés consiste à s'associer à des OSC qui travaillent déjà dans ces territoires et sont déjà connectées à la communauté, comme l'ISA (Instituto Socioambiental, par Fellow Beto Ricardo). Sur le plan conceptuel, Jerônimo travaille sur l'éducation environnementale, la sensibilisation sociale, la réglementation des lois et la production et la diffusion de contenus. Pour cela, le travail de Jerônimo est large, rassemblant divers acteurs : mouvements sociaux, secteur social, gouvernement, universités, secteur privé. À travers le projet Iraí, Jerônimo vise à diffuser la méliponiculture dans les espaces publics, tels que les écoles et les parcs. Il promeut l'éducation environnementale à travers la discussion des problèmes liés à la conservation des abeilles indigènes et forme de jeunes étudiants et de petits agriculteurs à la méliponiculture, à la production de miel et à la multiplication des colonies. Jerônimo est membre du mouvement Slow Food, dans lequel il est une figure clé des sujets liés aux produits apicoles indigènes. Son travail à cette instance a déjà abouti à deux motions de sensibilisation gouvernementale - une nationale, au ministère de l'Agriculture, et une latino-américaine, au Mercosur. Jeronimo a également des partenariats avec d'importants restaurants et chefs au Brésil, ce qui a attiré beaucoup d'attention d'un marché de consommateurs qui valorise les produits traditionnels, encourageant leur consommation et générant une demande. En termes d'action politique, Jerônimo a directement influencé l'inclusion historique des produits des abeilles indigènes dans le RIISPOA (Règlement de l'Inspection Industrielle et Sanitaire des Produits Animaux). Bien qu'il s'agisse d'un grand pas en avant, il ne fait que définir l'existence de ces produits. La véritable législation, qui réglementera en fait la chaîne de production, sera créée dans des résolutions spécifiques. Le défi est de construire un modèle non exclusif qui respecte la complexité et la diversité des espèces d'abeilles indigènes, la végétation brésilienne et la capacité de production des petits agriculteurs. Par conséquent, la priorité actuelle de Jerônimo est de créer une base technique pour la mise en œuvre de cette réglementation car, si elle n'est pas effectuée correctement, elle pourrait finir par uniformiser les pratiques et nuire aux petits producteurs. Ces connaissances n'existent pas encore formellement, donc Jerônimo utilise son travail technique et établit des partenariats avec des universités et des centres de recherche, pour analyser et systématiser les processus productifs locaux. Dans deux ans, Jerônimo aura un dossier complet à remettre au Ministère de l'Agriculture pour accompagner le processus réglementaire. Ce dossier prendra en compte les profils des éleveurs d'abeilles indigènes du Brésil, pour intégrer leurs capacités de production dans la réglementation. La logique de travail de Jerônimo est de préserver les gardiens de la diversité, et son travail peut servir de modèle pour valoriser et permettre la chaîne de production de miel d'abeille indigène dans d'autres pays d'Amérique latine, en plus de l'expansion potentielle à d'autres produits de la socio-biodiversité, qui sont souvent étouffés par le modèle homogénéisant de l'agro-industrie, comme le lait de chèvre.