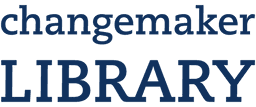Changemaker Library utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités améliorées et analyser les performances. En cliquant sur "Accepter", vous acceptez de paramétrer ces cookies comme indiqué dans le Politique de cookiesCliquer sur "Déclin" peut empêcher certaines parties de ce site de fonctionner comme prévu.
Cristina Bubba ZamoraBolivie • Ashoka Fellow depuis 1996
Cristina Bubba (Bolivie 1996) renforce les communautés autochtones andines en leur montrant comment tirer parti des conventions internationales pour récupérer d'anciens tissages cérémoniels qui leur ont été volés.
La personne
Cristina a grandi dans une famille nombreuse qui lui a fait comprendre et respecter l'individualité des gens. Enfant, elle a fait des voyages constants avec sa famille dans la campagne peu développée de la Bolivie où elle a appris à respecter et à admirer les agriculteurs indigènes ruraux et leur mode de vie. C'était une habitude de vacances inhabituelle, car les familles qui en avaient les moyens partaient généralement à l'étranger en vacances. Le racisme qu'elle a vu envers les peuples indigènes l'a laissée indignée et anxieuse de soutenir les groupes marginalisés et les pauvres en Bolivie. Cristina est une cousine de l'ancien président bolivien, Jaime Paz Zamora, qui était en poste au moment où elle a appris pour la première fois l'existence et le lieu où se trouvaient des tissages volés appartenant à la communauté de Coroma. Cristina a reçu une formation universitaire en psychologie sociale qui l'a aidée à comprendre les modes de pensée des différents groupes de personnes dans son pays. Elle a étudié avec le célèbre professeur d'anthropologie de l'Université Cornell, John Murra, qui est l'un des premiers universitaires à étudier l'importance culturelle des textiles andins. En 1982, lorsque l'Université bolivienne a été fermée pendant une crise politique et que le travail se faisait rare, Cristina a ouvert sa propre boutique d'artisanat. Elle a été inspirée pour le faire par son amour pour les textiles boliviens et son admiration pour le savoir-faire des tisserands. En tant que propriétaire de la boutique, elle a rapidement pu voir clairement le pillage du patrimoine culturel de la Bolivie et elle a été poussée à agir. Elle savait que les tissages étaient plus que de beaux morceaux de tissu et de vêtements. Elle a commencé à enquêter, à visiter les communautés et à en apprendre davantage sur le rôle que les tissages jouent dans leur vie quotidienne. Elle est venue à Coroma, un endroit où elle pouvait non seulement faire des recherches mais aussi aider à arrêter le pillage. En 1987, elle travaillait à Coroma en dressant un inventaire des tissages pour aider les chefs de village à identifier les pièces manquantes et à se protéger contre de nouvelles disparitions, lorsque le Dr Murra a envoyé la carte postale annonçant une exposition d'art indien antique à San Francisco avec une photo de l'un des disparus. tissages présents sur le devant. Ainsi commença son effort mondial pour protéger et récupérer les tissages cérémoniels.
La nouvelle idée
Cristina Bubba organise des Indiens indigènes Aymara dans la région de Coroma pour identifier, cataloguer et récupérer des tissages cérémoniels appartenant à la communauté, certains vieux de plus de 500 ans, qui ont été volés ou vendus à des marchands qui font le trafic illégal de ces tissages à travers le monde. Elle a formé des dirigeants autochtones locaux à l'utilisation des conventions de l'UNESCO qui protègent la propriété culturelle et spirituelle communale. Ce mouvement porte la question du trafic illégal de biens culturels à l'attention des populations en Bolivie et dans d'autres pays. Elle dynamise également l'organisation sociale des ayllus, le système traditionnel de gouvernance des hautes plaines des Andes boliviennes où vivent les Aymaras. Le système ayllu a fonctionné de manière continue depuis avant l'invasion des Incas au XVe siècle, mais il s'est affaibli au cours des développements politiques en Bolivie depuis les années 1950. Cependant, de récentes décisions gouvernementales offrent une ouverture aux ayllu pour revenir à des niveaux plus élevés d'autodétermination. La nouvelle loi sur la participation populaire, adoptée par le gouvernement bolivien à la fin de 1995, établit une politique de décentralisation des programmes gouvernementaux et de transfert de ressources à des groupes locaux reconnus, parmi lesquels les indigènes Aymara. Le travail de Cristina pour enseigner aux Aymara comment appliquer la loi en leur propre nom est particulièrement important dans ce contexte. L'engagement de Cristina à récupérer les tissages reflète sa conception de ce qu'ils représentent : que pour qu'une communauté prospère, elle doit protéger la qualité spirituelle de sa culture. Cela fait partie de sa contribution de montrer comment les gens ordinaires peuvent utiliser la loi pour soutenir ce processus.
Le problème
Dans les années 1970, les acteurs du marché international de l'art ont pris conscience de la variété et de la qualité exquises des anciens tissages cérémoniels boliviens datant de l'époque des Incas. Les collectionneurs parcouraient les Andes pour acheter ou voler les tissages. Ils ont été fabriqués sur des métiers à tisser à dos avec une laine si fine qu'elle ressemble à de la soie, puis teints avec des bleus, des roses, des jaunes et du noir naturels, puis tissés dans des motifs qui montrent les mouvements du soleil et des étoiles. Coroma est un grand ayllu de 30 villages de 14 000 pieds d'altitude dans l'Altiplano, les hautes plaines des Andes boliviennes, où les communautés cachent généralement leurs tissages jusqu'au 1er novembre, le jour des morts, puis affichent les vêtements rituellement dans un tout- célébration du jour de la connexion entre les mondes des vivants et des défunts. Les marchands profitaient de ces célébrations pour photographier les meilleurs tissages. Ensuite, ils remettaient les photographies à des intermédiaires boliviens, souvent les gardiens qui les stockaient dans des paquets cérémoniels appelés q'ipis lorsqu'ils n'étaient pas utilisés. Les marchands laissaient de l'argent et des instructions pour obtenir les vêtements. En 5 ou 6 ans, au moins 200 des tissages les plus fins et les plus précieux ont quitté Coroma pour les États-Unis où ils ont été vendus comme objets d'art pour des dizaines de milliers de dollars. Le processus s'est répété dans les communautés de toute la région andine, en particulier pendant les 6 années de sécheresse des années 1980, lorsque les gens mouraient de faim et émigraient vers les villes, et que l'autorité locale était affaiblie. La Convention de l'UNESCO sur les biens culturels interdit le commerce d'objets détenus en commun et constituant un patrimoine spirituel et culturel ; elle a été suivie en 1983 par la Loi de mise en œuvre de la Convention relative aux biens culturels. Cependant, il n'y avait pas de mécanismes établis pour faire appliquer la loi sur le terrain, et le gouvernement bolivien a fermé les yeux sur le commerce. De plus, les communautés n'avaient jamais composé les inventaires ou la provenance des tissages qui seraient nécessaires pour prouver le vol devant un tribunal. Pour les habitants des ayllus, la perte de leurs tissages signifiait un effondrement du rituel religieux et de l'organisation sociale. Les tissages racontent l'histoire de 500 ans des ancêtres de la communauté. Certains des tissus sont des vêtements officiels qui ressemblent à des ponchos et jouent un rôle important dans l'investiture de nouveaux dirigeants et d'autres cérémonies communautaires. Leur vol a violé l'intégrité de la communauté et miné ses modèles d'organisation à un moment où sa santé politique devenait de plus en plus importante. Au cours des années 1990, un mouvement populaire a vu le jour au sein de l'Ayllus - le boursier Ashoka Carlos Mamani est l'un de ses dirigeants - pour renforcer leur système et obtenir une reconnaissance officielle par le gouvernement bolivien. Les communautés ayllu sont basées sur des bassins versants. Le leadership tourne entre les familles ayllu, qui répartissent l'utilisation de l'eau et des terres, les modes de pâturage et d'autres problèmes communautaires de manière collective. Le système ayllu a très bien réussi à gérer les ressources foncières fragiles dans les zones rurales ; et les habitants ne migrent généralement pas appauvris vers les villes. Cependant, ils sont restés en dehors du développement moderne de la structure politique bolivienne, dans laquelle les partis politiques et les syndicats sont la forme dominante de représentation des citoyens. De plus, le gouvernement a superposé des municipalités au sein des territoires ayllu. La concurrence qui en résulte pour les ressources et le pouvoir a affaibli de nombreux ayllus et conduit à des conflits parfois violents sur la propriété foncière. Avec l'adoption de la loi sur la participation populaire en 1995, le gouvernement s'est engagé à décentraliser l'autorité et à canaliser l'essentiel des fonds publics vers les gouvernements locaux, y compris ceux des groupes autochtones officiellement reconnus, parmi lesquels les Aymara sont les plus importants. Cela a créé un moment d'opportunité pour un ayllus fort de participer au courant politique bolivien.
La stratégie
La stratégie de Cristina repose sur trois éléments. Premièrement, elle cherche à créer les mécanismes nécessaires pour faire respecter la loi et les conventions internationales. Parallèlement, elle organise le développement de la communauté ayllu à travers le processus de récupération des tissages. Un troisième élément est le développement d'une vision de ce que représentent les tissages et de la manière dont ils devraient être gérés à l'avenir. Le Coroma ayllu a été le projet pilote de Cristina. Elle a appris à la communauté, habituée aux récits oraux, à inventorier ses objets cérémoniels et à créer des descriptions écrites et des explications sur la signification des tissages rituels, q'ipis, coupes et autres objets. Elle travaille avec les gens à travers le processus d'application locale; y compris l'arrestation des gardiens qui vendent illégalement le patrimoine de la communauté et la décision difficile d'autoriser ou non le coupable à rester dans la communauté. Avec minutie, elle a mis en place le réseau nécessaire à l'application de la loi, en faisant appel à des avocats, des anthropologues, des douaniers internationaux, le gouvernement bolivien, les peuples autochtones et les médias. Les événements qui se déroulent ont illustré la nécessité d'établir des liens du niveau local au niveau international. En 1988, la communauté de Coroma a reçu une carte postale d'un professeur de l'Université Cornell spécialisé dans les textiles andins. Sa photo représentait un tissage indien qu'il avait vu en vente en Californie. C'était l'un des disparus de Coroma. Cristina est immédiatement partie pour San Francisco avec plusieurs anciens qui ont pu identifier le tissage. Elle activa alors les lois internationales qui soutenaient le principe que de tels biens détenus en commun ne pouvaient légalement être vendus sans l'assentiment de toute la communauté. Elle a travaillé avec un réseau d'universitaires, d'avocats et de membres de l'American Indian Movement pour attirer l'attention du public sur le trafic illégal; et de persuader les États-Unis de prendre des mesures dans le cadre de la Convention sur les biens culturels de l'UNESCO et d'imposer des restrictions d'urgence à l'importation sur les textiles anciens de Coroma pendant 5 ans. En guise de suivi, le registre fédéral a publié une liste - que la communauté pouvait désormais fournir - des textiles dont l'entrée avait été refusée. Plus de 1 000 tissages boliviens ont été confisqués par les douaniers de San Francisco. Beaucoup étaient des tissages cérémoniels et les anciens de Coroma ont pu identifier et documenter 48 d'entre eux. En 1993, les textiles ont été remis aux Boliviens et un groupe d'Indiens d'Amérique les a ramenés chez eux à Coroma le 1er novembre, le jour des morts. Le ministre de la Culture en France, où il y a eu un important trafic d'art andin volé, a entendu parler de l'histoire, et lorsqu'il s'est rendu en Bolivie avec le Premier ministre Chirac en 1996, il a demandé à voir les tissages restitués. Une exposition spéciale a été organisée au Musée national d'art de La Paz. Des membres de la communauté de Coroma dirigeaient une cérémonie à son arrivée. Avec l'aide d'un Aymara francophone, ils lui ont présenté un projet de proposition de traité entre leur ayllu et le gouvernement français pour faire respecter les dispositions de la convention de l'UNESCO et assurer le retour des tissages cérémoniels. Il a suggéré qu'ils forment un "musée vivant", financé par le gouvernement français, où les textiles pourraient être sauvegardés, les gens pourraient être éduqués à leur sujet et les techniques de tissage pourraient être ravivées et enseignées. Un groupe d'un ayllu qui peut proposer son propre traité avec un pays étranger manifeste sa confiance. Cristina a travaillé pour renforcer les modèles de gouvernance existants dans l'ayllu et pour créer des réseaux entre l'ayllus et d'autres institutions. Alors qu'elle s'est concentrée sur d'autres questions telles que l'acquisition de titres fonciers, son objectif principal a été la récupération des tissages, et son organisation de la communauté évolue à partir de ce thème. Elle a aidé les communautés touchées par des campagnes de relations publiques pour sensibiliser le grand public à l'importance de préserver leur patrimoine culturel. Elle travaille avec les gouvernements locaux de Coroma et de Sucre pour créer un musée vivant du textile. Elle travaille avec le gouvernement national pour établir un musée national du textile à La Paz et pour créer une institution officielle d'experts en textile. Elle reproduit son travail dans d'autres communautés indigènes ayllu de l'Altiplano bolivien. Tant que les tissages n'auront pas été documentés et que leur vol n'aura pas été découvert et enregistré, il n'y a aucun espoir de récupérer ces trésors. Cristina a changé la réalité de l'exécution en Bolivie. Avec son aide, le Congrès a défini une nouvelle politique pour faire respecter la protection juridique, a ordonné aux douanes boliviennes de confisquer les tissages volés et a passé un contrat avec Cristina pour les former. Ils ont fait leur première récupération à l'aéroport de La Paz en mars 1997. Au niveau international, Cristina a joué un rôle déterminant dans la création d'un réseau de soutien pour tout signalement de vol lié au trafic de biens culturels. Elle participe à des événements où n'importe quel aspect du tissage cérémoniel est impliqué. Le gouvernement de l'État de Sao Paulo au Brésil l'a invitée à parler au Congrès latino-américain des musées sur l'éthique des musées et sur la façon dont les musées peuvent faire face à la prise de conscience qu'une partie de ce qu'ils exposent a été volée à une culture spirituelle en cours. Le gouvernement équatorien lui a également demandé d'expliquer son modèle pour faire face au problème. Cristina et les habitants de Coroma travaillent maintenant à la récupération de tissages au Canada, en Europe et au Japon.